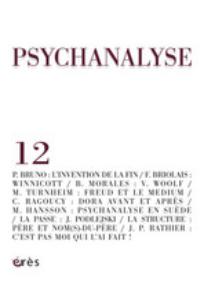Le père chez Freud
mai 2008
THÉORIE
L’invention de la fin. Pierre Bruno
Ce titre indique une thèse, à savoir que ce qu’on appelle « fin » d’une psychanalyse (je retiens le terme de « fin » dans l’acception désormais courante qu’il a dans le texte princeps de Freud, « Analyse avec fin et analyse sans fin » [1937]) est le résultat d’une invention. Comme toute invention (invention du feu, du cinéma, de l’avion…), elle peut se perfectionner, ou plutôt, pour ne pas utiliser un terme à connotation finaliste ou moralisante, elle évolue. Je n’entends pas proposer l’histoire de cette invention. À vrai dire, une invention, même si elle peut se faire en plusieurs étapes, est intrinsèquement discontinue. Il y a un ou des « avant » et un ou des « après ». Ce que je voudrais en revanche souligner est que la découverte de l’inconscient, aussi extraordinaire soit-elle, est menacée en permanence d’un recouvrement, d’une dénaturation, tant qu’elle n’est pas fondée après coup par l’invention de la fin. Sans cette invention, le concept d’inconscient reste vulnérable et perméable à toutes sortes de falsifications, comme, par exemple, celle qui a fleuri du vivant de Freud, sa dégradation en subconscient.
« La vraie bévue de Freud ». Un os dans la théière de Winnicott. Florence Briolais
La tendance de tout ce qui vit à retourner au repos du monde anorganique domine la vie psychique et la vie en général. Repérée cliniquement sous sa forme d’« éternel retour du même » dans les rêves des névrosés de guerre, les jeux d’enfants, la névrose de transfert et les névroses de destinée, cette tendance est ce qui motive Sigmund Freud, en 1920 dans son article « Au-delà du principe de plaisir », à affirmer « sa croyance en l’existence de la pulsion de mort ». Donald Woods Winnicott (1896-1971), médecin pédiatre et président à deux reprises de la Société britannique de psychanalyse, est celui qui, en 1952, dans une de ses « lettres vives », se situe radicalement contre ce concept freudien de « pulsion de mort ». Pour lui, « les pulsions de vie et de mort sont peut-être la vraie bévue de Freud 3 ». Et il commente ainsi son point de vue : « Ce concept a été introduit par Freud parce qu’il n’avait pas la moindre notion de la pulsion amoureuse primaire » Dans un souci progressiste et positiviste, Winnicott va rejeter le concept freudien et méconnaître son véritable enjeu, tel que Freud l’avait saisi dans cet au-delà du principe de plaisir ; il en fait une bévue. L’enjeu de notre article est donc de revisiter cette conception winnicottienne de pulsion amoureuse primaire.
Virginia Wolf entre maladie et l’écriture. Bibiana Morales
« Ai-je le pouvoir de rendre la véritable réalité ? Ou écris-je des essais sur moi-même ? » Est la question que se pose Virginia Woolf. Elle interroge ce lien inextricable entre sa maladie et l’écriture de ses romans, qui parfois sont très proches de ses « visions » et du réel de l’hallucination. Comment se servir de la folie pour faire de l’art ? En tant que romancière, elle voulait transmettre du sens esthétique et non du délire. C’est dans les moments de maladie qu’elle trouvait la naissance et la suite de ses romans, donnés par ses visions. Sa création consistait à faire passer ce qu’elle avait de plus particulier, sa folie, dans une fiction accessible au lecteur. Virginia Woolf croyait à l’écriture comme thérapie. Écrire était pour elle faire passer le mal par écrit. Mais son écriture ne la protégeait pas des effets mortifères de chacune de ses crises, et elle ne l’a pas empêchée non plus de se suicider. Chaque livre et surtout chaque publication l’amenaient au franchissement de ses limites. L’écrivain allait au-delà d’elle-même en signant, avec sa création, son entrée dans la psychose. Lacan appelle ce franchissement « le drame subjectif du savant ». Il est le coût subjectif de l’invention où l’inventeur est victime des limites par la création. Quelle est la création de Virginia Woolf ? Si l’écriture fonctionnait comme suppléance pour Virginia Woolf, paradoxalement elle conduisait aussi à une impasse.
Freud le médium (Notes sur l’affaire de la télépathie). Mickaël Turnheim
En lisant les textes de Freud sur la télépathie, on est frappé par une rhétorique étrange : d’une part, exigence de la « plus stricte impartialité », d’autre part, signes nets à la fois de fascination et de dégoût. Les lettres à Ferenczi montrent que la question ne le lâche pas. À Eitingon, il écrit que l’occulte, comme le débat Bacon- Shakespeare, le « fait chaque fois perdre contenance ». Tout en affirmant que l’intérêt pour la télépathie relève d’un désir de se retirer de la rationalité (« tentations du principe de plaisir »), Freud pense que l’acceptation de son existence réveille, tout comme la psychanalyse, des résistances (« prétention au savoir des gens instruits ») qu’on devrait surmonter courageusement. Le refus, inhabituel chez Freud, d’assumer la responsabilité de ce qu’il dit donne des tournures parfois presque comiques : « À partir de ma conférence vous n’apprendrez rien sur l’énigme de la télépathie, et vous n’obtiendrez pas même d’information sur cette question : crois-je ou non à l’existence d’une “télépathie” » Pour des raisons sur lesquelles je reviendrai, tout doit rester indéterminé: l’expéditeur, le destinataire et le sens même du message. C’est pourquoi il n’est pas indifférent qu’il s’agisse, avec les textes de Freud sur la télépathie, de cours ou de conférences qui n’ont jamais été tenus : bouteilles à la mer.
LE CAS
Dora avant et après Freud. Christine Ragoucy
À la différence de l’Homme aux loups, il n’existe pour Dora ni véritablement de récit analytique ultérieur, puisque son travail analytique s’est arrêté avec Freud, ni de recueil d’entretiens ; à la différence de « la jeune homosexuelle », il n’existe pas de récit (auto) biographique. « Dora avant et après Freud » fait ainsi suite à l’article de Karin Adler, « Ida Bauer, la Dora de Freud », qui a présenté les grands traits de la biographie d’Ida Bauer. Je reprendrai de façon plus détaillée les éléments biographiques dont on dispose sur Dora, de façon différente selon qu’il s’agit de la période avant l’analyse menée avec Freud et son récit clinique « Fragment d’une analyse d’hystérie » publié en 1905 ou après.
L’ASSOCIATION
Fragments de l’histoire de la psychanalyse en Suède. Malena Hansson
Toutes les informations de cet article sont tirées de la thèse de doctorat de Per Magnus Johansson : La psychanalyse de Freud, Des héritiers en Suède, publiée en deux tomes. C’est un ouvrage très complet et détaillé sur le mouvement de la psychanalyse freudienne en Suède ainsi que sur dix analystes, praticiens et écrivains, avec chacun son style et sa manière d’aborder l’œuvre de Freud. Il est impossible, bien que l’envie ne manque pas, de tout traiter dans cet article. Je ne prétends donc pas donner une vision complète de l’histoire de la psychanalyse en Suède. Ce article constitue plutôt la reconstitution d’une lecture personnelle de ce doctorat et les points que j’ai eu envie de soulever et de transmettre aux lecteurs de Psychanalyse de ma place de psychanalyste suédoise, formée et exerçant en France, découvrant un morceau d’histoire et d’héritage de la psychanalyse de mon pays d’origine. Je me permets d’ajouter à la fin une petite note sur l’œuvre de Lacan en Suède, ainsi qu’un mot sur l’Association freudienne à Göteborg.
LA PASSE
Droit de cité. Jacques Podlejski
Il y a au moins deux façons d’attraper le thème retenu pour la journée sur « La cité dans la psychanalyse ». Cela évoque l’intervention de la cité, conçue comme extérieure à notre champ, comme venant impacter, voire menacer, par ses lois, par ses réglementations, par les modes de régulation sociale qu’elle promeut, les conditions d’exercice de la psychanalyse. J’ai choisi un autre versant, celui de considérer le groupe analytique comme une cité, selon le sens qui prévalait dans la Grèce antique où ce mot désigne un ensemble de personnes qui s’assemblent sous des institutions communes. On peut à bon droit parler de la cité de la psychanalyse, ou plus précisément des cités de la psychanalyse, dans la cité, pris au sens de l’État moderne.
J’ai été nommé AE, analyste de l’École, après m’être présenté à la passe à la cité APJL. J’ai donc été nommé AE par l’APJL. Mais c’est au sein d’une autre cité analytique – l’École de la Cause freudienne (ECF) – que j’ai effectué le parcours analytique qui, transmis dans le dispositif de la passe, a déterminé cette nomination. Si je suis donc là à vous parler, de cette position d’AE, c’est à ces deux cités que je le dois. En résumé, l’ECF a produit le passant, l’APJL a produit l’AE.
LA STRUCTURE
Père et Nom(s)-du-Père (1ère partie)
Il est manifeste et remarquable que le questionnement de Freud quant au père a émergé dans sa correspondance avec Fliess, et qu’il porte, quelquefois de façon intime, sur le rapport subjectif du fils à son père. Le père freudien gardera cette marque de naissance, l’analyse originelle de Freud, et ne doit rien à une réflexion académique. Les prédicats vont se succéder : séducteur, mort, impuissant, idéal, terrible, etc. Par un renversement, Lacan va reprendre la question du père à partir de son nom, puis de ses noms. Parallèlement, il propose une matrice possible de la structure qui rende intelligible la conséquence, chez l’humain, de son être langagier, au moyen de la tripartition : père réel, père symbolique, père imaginaire. Cette formulation, à elle seule, attire l’attention sur le fait que la fonction paternelle relève du nommé/nommant. Enfin, dans un de ses derniers séminaires, sur Joyce, il s’interrogera sur ce qui pourrait suppléer à cette fonction quand elle est suspendue : le sinthome. Si ni les élèves contemporains de Freud, ni les post freudiens n’ont sensiblement remis en cause ce que Freud dit du père et ont plutôt (M. Klein, D. Winnicott) développé une contribution concernant la mère, les élèves de Lacan, en revanche, n’ont pas la même lecture du legs lacanien sur le père et ses noms. On notera au moins une bipolarisation entre ceux qui insistent sur le caractère transcendant et irremplaçable de la fonction paternelle et ceux qui considèrent que l’élaboration de la catégorie de sinthome minimise et relativise la portée de cette fonction.
EXTÉRIEURS
C’est pas moi qui l’ai fait ! L’autoportrait en regard de la psychanalyse. Jean-Paul Rathier
Le genre autobiographique m’ennuie. Quant à l’autofiction – gadget éditorial de plus en plus prisé et primé par les médias –, j’y suis allergique, définitivement. Loin de ces boursouflures d’un narcissisme pathologique, je préfère fréquenter les œuvres d’artistes et d’écrivains qui, dans l’expérience de l’autoportrait, se risquent à dire ou à montrer ce « peu de soi » auquel les réduit, comme par nécessité, leur acte de création. Ainsi la parole solitaire de Beckett qui dans Mal vu mal dit en vient à s’exclamer : « Moindre. Ah le beau seul mot », « moindre minimement. Pas plus 1 ». Un art du suspens, du retrait et de l’ascèse, qui n’est pas sans rapport avec l’invention du sujet dans la cure analytique, quand un dire enfin désencombré des historiettes autobiographiques, qui jusque-là faisaient écran, parvient à se faire entendre dans ce « murmure à peine » où transite un presque rien délogé de son écrin de silence.
Vous pouvez accéder aux articles de ce N° sur CAIRN