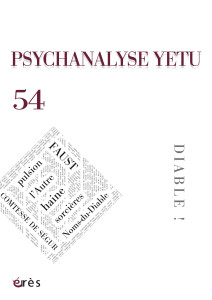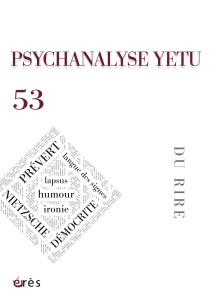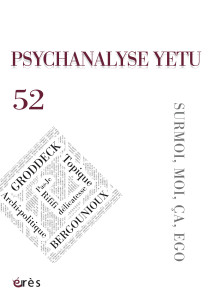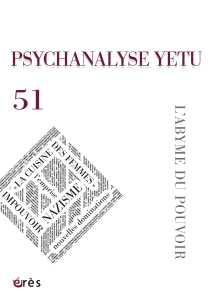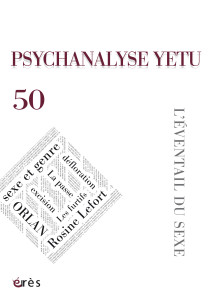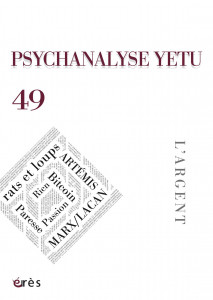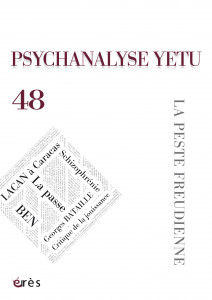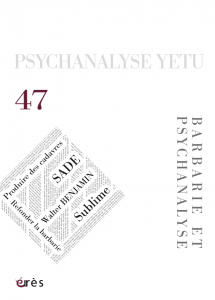LA PESTE FREUDIENNE
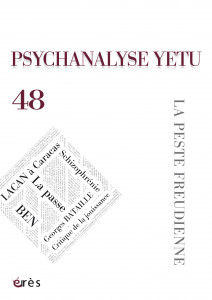
LA PESTE FREUDIENNE
Peste, aller et retour. Guy Lérès
Résumé : A l’aller, Freud était prévenu des difficultés qu’allait rencontrer son invention aux USA. Au retour n’est-ce pas le capitalisme USA qui allait s’armer contre la psychanalyse en Europe.
Mots-clés : Puritanisme , Anhistoricisme, Argent-roi ,Science ,Sujet ,Capitalisme.
Supplémentaire. Marie-Jean Sauret
Résumé : Supplémentaire présente au moins quatre acceptions : courante, mathématique, psychanalytique (avec l’hapax de la jouissance supplémentaire), topologique. Ils ont en commun de désigner une dimension inaperçue : dont s’éclaire l’acte nécessaire au faire Ecole au-delà de l’association.
Mots-clés : complémentaire, jouissance phallique et supplémentaire, lien social, Marx, passe, rapport sexuel, symptôme.
Une présence discrète. Zineb Bou Salah
Résumé : La psychanalyse s ‘inscrit dans des contextes historiques particuliers qui sont aussi des contextes nationaux. L’histoire de l’Algérie permet de souligner quelques conditions et possibilités de sa présence passée et à venir.
Mots-clés : savoir, idéal, capitalisme, nationalisme, décolonisation, histoire de la psychanalyse.
Une allocution : Lacan à Caracas. Maria Antonieta Izaguirre
Résumé : A l’occasion des 40 ans de la visite de J Lacan à Caracas, Maria Antonieta Izaguirre a transmis en 2020 à Caracas, ce moment historique à un public qui n’a pas eu la chance d’être présent lors de cette rencontre. Le voyage de Lacan à Caracas a rempli sa fonction : celle d’installer la psychanalyse en Amérique du Sud grâce au désir de Lacan, de Diana Rabinovich et de tous ceux qui ont œuvré pour rendre possible cette rencontre.
Mots-clés : Lacan, Caracas, Diana Rabinovich, Amérique du Sud.
Critique de la jouissance. Pierre Bruno
Résumé : Il est impossible de parler de jouissance sans partir de la perte qui la constitue, au-delà du principe de plaisir et du principe de réalité.
Mots-clés : frustration de jouissance, privation de perception, jouissance pas-toute.
LA PASSE
Préambule. Marie-Jean Sauret
Résumé : L’invention de la passe n’a pas éradiqué les crises qui jalonnent le mouvement psychanalytique. Elle a mis en évidence leur raison : ce que l’analysant extrait de sa cure et sur quoi il ne peut céder sans renier son rapport à la psychanalyse. Ainsi que Lacan, « il est seul dans sa relation à la cause analytique », dont il se soutient à s’expliquer avec quelques autres. D’où une série de questions auxquels quelques analystes s’efforcent de répondre en tenant compte et de l’expérience collective et de ce que la cure leur a enseigné : Sidi Askofaré, Pierre Bruno, Monique-Cécile Drouet, Fabienne Guillen, Francis Hofstein, Isabelle Morin, Jacques Nassif, LaureThibaudeau.
Mots-clés : AE, crise, dissidence, Discours Analytique, « du » psychanalyste, échec de la passe, Ecole, fin (d’analyse), institution, sinthome.
Sidi Askofaré, Pierre Bruno, Monique-Cécile Drouet, Fabienne Guillen, Francis Hofstein, Isabelle Morin, Jacques Nassif, Laure Thibaudeau
LE CARDO
Le dispositif des Rencontres cliniques freudiennes. Abel Guillen
Résumé : En s’appuyant sur l’expérience des « présentations de malades » réalisées par Lacan de 1955 à 1980 à l’hôpital Sainte-Anne, l’association Le Cardo a mis en œuvre un nouveau dispositif nommé Rencontres cliniques freudiennes. Ce dispositif tente de parvenir à une subversion des présentations de malades. Nous en attendons qu’il offre les conditions pour des moments d’émergence du discours analytique.
Mots-clés : Cardo, psychose, présentation de malades, hôpital psychiatrique, discours analytique.
Sur les traces du désir dans la psychose : trois rencontres à l’hôpital psychiatrique. Abel Guillen
Résumé : L’association Le Cardo a mis en œuvre un nouveau dispositif nommé rencontres cliniques freudiennes au sein d’un hôpital psychiatrique. A partir de trois rencontres de sujet psychotiques dit schizophrènes, nous tenterons de mettre en évidence les traces de leur désir et d’en éclairer les spécificités.
Mots-clés : désir, psychose, schizophrénie, présentations de malade, cardo, psychiatrie.
D’un dit schizophrène à un dire. Sacha Dreyfus
Résumé : Au-delà de la question du diagnostic D. réinterroge la mise en jeu de la pure représentation du mot. Ce faisant il nous invite à reposer la question du discours établi dans lequel peut venir se loger un sujet et donc en conséquence la psychanalyse à l’endroit de son offre.
Mots-clés : dit schizophrène, discours, transfert, dire.
LA RUELLE DU DESIR
Georges Bataille, « atteindre l’impossible » ? Laure Thibaudeau
Résumé : Forcer l’extrême, telle a été l’ambition de Bataille : extrême du sexe, de la mort , de la langue. Mais en refusant la castration, il n’a pu que s’y heurter implacablement.
Mots-clés : sexe, mort , langue, jouissance, impossible.
L’expérience intérieure : Lacan, Bataille, de Foligno. Pierre Bruno
Résumé : Analyse de L’expérience intérieure de Georges Bataille comme contre-exemple du « procédé analytique ».
Mots-clés : Georges Bataille, Angèle de Foligno, expérience intérieure, procédé analytique.
Sade sans chiqué. Jessie Cohen
Résumé : L’objet de ce texte est de tenter d’éclairer la conception du masochisme chez Lacan à travers les deux schémas du fantasme sadien (Kant avec Sade) en prenant appui sur son séminaire, et, à partir de là, y spécifier la position de Sade en tant que sujet désirant.
Mots-clés : Sade, fantasme sadien, masochisme, chiqué.
Se faire « passeur » du Guerrier appliqué. Christian Cros
Résumé : C’est à partir de la proposition d’octobre 67 sur la passe, que Jacques Lacan prenant appui sur sa lecture du livre de jean Paulhan « le guerrier appliqué » va inviter ses élèves à le lire, voire à s’en inspirer, pour s’éclairer sur ce qui portera nom de « destitution subjective », cela n’est pas sans évoquer l’état du sujet en fin de cure.
Mots-clés : destitution subjective – effet d’être – péril – cruauté – appliqué.
LA LISEUSE
La Terreur en personne. Thérèse Charrier
Résumé : Pierre Michon avec Les Onze a écrit le réel de la Terreur. L’auteur relie l’ effet saisissant de la lecture, à l’art épiphanique de Pierre Michon et son effet de présence réelle ; à son écriture autour d’un vide organisateur et de la place vide de Plus-Personne, d’où se profère une voix qui se fait entendre depuis le creux entre les générations. La dimension de l’impersonnel de la Terreur en personne, est convoquée chez le lecteur en son point le plus intime .
Mots-clés : Réel de la terreur. Présence réelle. Place de Plus – Personne. Art épiphanique. Anamorphose.
EXTERIEURS
Une langue pour chaque peuple. Ben Vautier
Résumé : L’artiste Ben Vautier propose aux lecteurs de la revue une présentation de ses arguments en faveur de l’ethnisme de Fontan,
Mots-clés : BEN, ethnisme, Fontan, langue, peuple
Y ETU
Selon que vous serez puissant ou misérable
Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir.
Jean de La Fontaine, Les animaux malades de la peste.